7 CHEFS d'OEUVRE des Frères COEN

Les frères Coen et Jeff Bridges
ShutterstockIls sont depuis des lustres les surdoués du cinéma indépendant US. Tour à tour grinçant, absurde, violent, cynique, amoral, déconnant, tragicomique, leur univers cinématographique réinvente de vastes pans de la culture populaire américaine. Retour sur 7 de leurs plus grands films.
Les frères Coen sont deux : Joel et Ethan, chacun a son homonyme à Hollywood (un Etan sans « h » ; et un Joel avec « H » à Cohen). Joel Coen est souvent indiqué comme seul réalisateur, l’autre étant plus le producteur. Ils sont également leurs scénaristes, et Wikipédia souligne que « leur collaboration est tellement étroite et complémentaire qu'on les appelle parfois le réalisateur à deux têtes ».
À première vue, on pourrait les prendre pour deux aimables farfelus, voire un peu timbrés. C’est vrai qu’ils ont ce petit côté débarqué, semblant parfois deux clones tant leurs mimiques les rapprochent. Mais on sait surtout qu’ils sont deux encyclopédies du cinéma et de la littérature américaine (polars et films noirs, mais pas seulement), qui adorent triturer des histoires parfois inspirées de classiques, pour y glisser ce talent inné et inégalable de la dérision, peindre l’absurdité du monde et l’insondable bêtise humaine. Un fil rouge de leur œuvre serait la capacité qu’ont certains êtres humains standard, à peine plus cons que la majorité d’entre nous, à s’embarquer dans des histoires tordues où ils perdront soit la vie, soit leur âme, soit leurs derniers espoirs. Et à mesure qu’ils s’entêtent et s’acharnent à trouver des portes de sorties, ils s’enterrent évidemment, toujours plus, dans l’erreur et la mélasse. Ils offriraient si l’on veut l’illustration cinématographique de la formule émise en son temps par Paul Watzlawick : « Faire davantage de ce qui n’a pas marché, en étant convaincu que ça finira forcément par marcher ». Formule résumant en somme « Comment réussir à échouer ». Presque tous les héros coeniens, chacun à sa façon, en seraient de confondantes illustrations, relevées souvent par l’odeur et la saveur du sang versé.
Incidemment, les deux Brozz ont raflé tout ce qui peut s’envisager comme récompenses. Oscars, pour eux ou leurs acteurs, Palme d’Or, Awards et tutti quanti. Certes, leurs deux derniers films n’ont pas vraiment convaincu : « Hail, Caesar ! » ne grimpait pas bien haut, et bien décevante fut pour Netflix leur « Ballade de Buster Scruggs ». Reste l’essentiel de leur œuvre, hautement, chaudement recommandable, ce qu’on fera ici avec enthousiasme et joie. Seule difficulté ? S’en tenir à 7… Mais choisir c’est renoncer, n’est-ce-pas ? Les sept qui suivent sont énumérés, mais sans classement aucun.
| 1 | Films des frères Cohen : Fargo |
Commencer avec l’indispensable hommage dû à Frances McDormand, épouse de Joel Coen, présente sur bien des génériques du mari et du beauf. Elle reçut pour Fargo, l’Oscar de la meilleure actrice, et avouons qu’elle y est extraordinaire, dans tous les sens du terme. Au reste, l’univers coenien serait sans elle bien moins abouti.
Fargo est un étrange théâtre : le Dakota du Nord sous la neige, c’est quelque chose… C’est aussi un accent, celui des habitants du coin, qui placent des « Oh Yeah ? » à chaque fin de phrase ou presque. On est là tout près du coin où grandirent Ethan et Joel, (Nebraska) et où ils reviendront plus tard avec le très étrange « A serious man ». Fargo est un exemple type : tout va, pardonnez l’expression, « partir en couilles », simplement parce qu’un crétin croit bon d’engager deux tordus pour enlever sa femme, et demander une rançon au père de celle-ci, bourré de thunes alors que lui est endetté. Jusqu’aux os. Rien ne va fonctionner comme envisagé au départ. La surprenante policière enceinte - jusqu’aux yeux - « ne va rien lâcher », pister l’équipe de tocards dont l’un est un psychopathe manifeste, les suivre jusqu’à la résolution finale de ce qui sera devenu un méchant sac de nœuds. Le film contient des séquences hilarantes pour peu qu’on goûte le genre humour noir, et c’est très joli, finalement, ces flaques de sang dans la neige. Fargo est du genre mythique. Le casting fonctionne au poil, avec notamment Peter Stormare en psychopathe épatant. Avec pour compère un Steve Buscemi aussi lunaire qu’il sait l’être, mais cette fois en mode volubile.
Fargo a depuis donné lieu à une mini-série sur Netflix, où les Coen Bros sont simplement producteurs. Chaque saison raconte une histoire indépendante, ce qui est bien le meilleur des formats, de mon modeste point de vue.
| 2 | Films des frères Cohen : Inside Llewyn Devis |
Dans la filmo des frères Coen, la musique tient souvent une place de choix, comme chez Tarentino. Lorsqu’ils décident d’en faire un élément central du film, ils en confient volontiers le dossier au grand guitariste et producteur T-Bone Burnett. Ce fut le cas pour O’Brother, pour LadyKillers également. Et ça l’est pour ce film magnifique, Grand Prix du Jury à Cannes 2013. On est au tout début des années 60 à Greenwich Village (Manhattan, New York). La musique folk, la culture beat, sont en pleine expansion, des clubs ouvrent, notamment ce Gerde’s Folk City, où de jeunes gens s’essaient avec plus ou moins de succès au travail d’interprètes. Tom Paxton, Dave Van Ronk, Ramblin’ Jack Elliott resteront dans les mémoires. Peter Paul and Mary auront une longue et belle carrière internationale… Et d’autres seront oubliés. Llewyn Davis serait l’un de ceux-là, même si son histoire emprunte beaucoup aux premières années de Van Ronk, s'appuyant sur ses mémoires. Entre petits sets dans les petites salles, tentatives de disques qui ne marchent pas malgré une bien belle voix, mais peu de charisme, on suit les errances de Llewyn, ses plans incrustes chez des amis bienveillants, sa tentative épique auprès d’un vrai producteur, qui évoque clairement le « vrai » Alfred Grossmann, peu avant que celui-ci ne décroche, "dans la vraie vie", le big jackpot.
Davis rame, Davis revient à son point de départ, à déçu sa petite amie, s’enlise… On le retrouve à la fin, dans le même club qu’au début. Une silhouette passe, on la distingue à peine, elle prend la suite derrière ce bientôt has-been. La voix qui s’entend est bien celle qu’on imaginait. Un jeune Robert Zimmermann, depuis peu renommé Bob Dylan. L'histoire fait place à l'Histoire.
Le film est beau, les voix formidablement choisies : Oscar Isaac, acteur principal et interprète, est excellent. Justin Timberlake impeccable, le chanteur Marcus Mumford figure aussi dans la bande originale, laquelle contient une magnifique version du classique folk « 500 miles », dans l’esprit de Peter Paul & Mary. Titre hélas plus connu chez nous via Richard Antony, pour un « j’entends siffler le train » aussi mielleux que l’original est lumineux. La BO offre aussi un inédit de Dylan pour le générique de fin… C'est dire qu’elle vaut autant que le film, lequel croula sous les récompenses dans le circuit US indépendant, et reçut également deux Oscars dont celui de la photo. Vous voulez un autre bonus? Le film comporte un long passage avec un John Goodman époustouflant.
| 3 | Films des frères Cohen : No Country For Old Men |
De tous, assurément le plus noir, le plus violent, le plus angoissant. Il faut dire que Javier Bardem (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle) y est probablement le plus effrayant psychopathe jamais croisé sur un écran. Le plus glaçant, le plus tordu… Dans une interview, l’acteur confiait avoir cherché à y incarner « le mal absolu ». Et oui, il y a quelque chose en lui de non humain, dans cette façon de déchaîner la violence avec la nonchalance du type en train de refaire les lacets de ses pompes. Il fascine, fait horreur, et au but du compte, amuse. Totalement barré.
Qu’une valise bourrée de dollars puisse par ailleurs rendre fous une poignée de types placés de l’un et l’autre côté de la Loi, n’a rien en soi de nouveau. Mais la façon de le raconter des deux Coen l’inscrit dans une apparente normalité, quasi banale, sans surenchère. Que voulez-vous y faire, ce monde est brutal, et ce sud de l’Amérique, aux frontières du Mexique, « n’est pas un pays pour les vieux ». Cette traque qui tourne à la boucherie, impliquant aussi Tommy Lee Jones et Josh Brolin, obtint l’Oscar du Meilleur Film, celui du meilleur réalisateur, sans oublier celui du meilleur scénario adapté, à partir d’un roman de Cormac McCarthy.
"Objectivement", pour autant qu’il soit possible de faire abstraction de ses propres affects, celui-ci serait leur sommet. Mais ça peut se discuter. Qui donc a jamais prétendu qu’il fallait être objectif en matière de goûts ?
| 4 | Films des frères Cohen : Blood Simple (Sang pour sang) |
Leur premier essai. Un coup de Maîtres, affirme l’excellent livre consacré à leur œuvre, Oh Brothers ! On trouve dans ce film de 1984 bien des ingrédients qui constitueront le sel et le piment de leur œuvre à venir. Une histoire bien tordue, perverse. Chacun y joue double ou triple jeu, le remords n’y trouve aucune place, les viles pulsions sont reines, chacun chacune s’élimine sans ciller, dans un genre de patelin texan où personne n’aurait l’idée de mettre un pied.
Frances McDormand y tenait le rôle principal, faisant ici ses débuts sur grand écran, , infidèle épouse toute mignonne, loin d’être marquée par les quelques rides qui lui sont aujourd'hui venues, elle qui semble résister aux tentations du lifting. Et elle a bien raison.
Le film comporte une séquence d’une quinzaine de minutes qui fit grand bruit à sa sortie. Comment ces deux « rookies » avaient-ils pu oser ? Avait-on affaire à deux authentiques malades ? Plus simplement, à deux fondus de films d’horreur et d’Alfred Hitchcock, résolus à aller au bout de leurs délires.
En ce sens Blood Simple était une promesse qui serait toujours tenue, et largement !
| 5 | Films des frères Cohen : Barton Fink |
Sorti en 1991, ce quatrième "opus" (comme on dit pour ne répéter dix fois le mot "film") fit une razzia au Festival de Cannes, emportant la Palme d'or après le Prix de la mise en scène. John Turturro rafla le Prix d'interprétation masculine, et s’il y en avait eu un pour le second rôle, nul doute qu’il eut été pour John Goodman, leur acteur fétiche. Goodman confia dans une interview, « Les frères Coen me demandent de jouer le rôle du trou du cul de la vache dans leur prochain film? Je viens. Et je joue le rôle du trou du cul de la vache ».
C’est parce qu’ils étaient en panne d’inspiration que les frangins écrivirent en trois semaines cette histoire d’un scénariste... en mal d’inspiration. Comme quoi…
Le "pitch" ? Dans les années 40, un jeune auteur à succès de Broadway, quoique timide et réservé, se retrouve engagé comme scénariste pour Hollywood. Pour très vite se rendre compte qu’il n’a pas fait le bon choix, que l’industrie du film va l’y pressuriser comme le citron … Mais comme un fait exprès, c'est précisément au moment où il se trouve en panne créatrice. Et le voilà placardé dans un hôtel miteux, envahi par l’angoisse ainsi que par un voisin du genre collant. L’histoire dérape dans le tristounet, puis dans la folie. Turturro y sera pathétique et totalement perdu (mais son interprétation est géniale). De Goodman mieux vaut ne rien dire, mais son interprétation est une fois de plus géniale. L’ambiance sombre corps et bien, vire au cauchemar, on l’a comparée à Kafka… Quant au final… N’en disons rien, sinon que la vie n’est pas toujours un chemin de roses. N’est-ce pas, Mister Fink ?
| 6 | Films des frères Cohen : Burn After Reading |
Celui-ci, un peu comme The Big Lebowski, vous attrape à la sournoise. On se lance une première fois, l’intrigue semble alambiquée, on se demande où ils vont en venir... encore une de ces impasses absurdes dont ils ont le secret.
A peine dix minutes passent, on se sent happé par cette galerie de névrosés surchoix. Les deux cerveaux d’Ethan et Joel réunis, font un sacré modèle de Cabinet de curiosités... La mécanique imparable vous accroche, des phrases culte s’insinuent (« I’m the Good Samaritan »). Vous savourez un Brad Pitt hilarant en monsieur muscles décérébré, péroxydé, mytho… George Clooney joue le parfait crétin obsédé sexuel (il note chez Coen, il est abonné aux rôles d'abruti). Le voilà parti pour un plan avec une Frances McDormand à la fois nympho… et anorgasmique à ce qu’il semble ; sans oublier John Malkovich en agent secret mis sur la touche, alcoolique et parano. Tous ces ahuris se retrouvent pour de bon pris dans un tourbillon complotiste, l’Amérique « blanche et bourgeoise » y est devenue un champ de bataille idéal pour féministes impitoyables. Ne manquerait plus qu’arrive un Donald Trump pour que la bérézina soit complète… Le film ne l’annonce-t-il pas un peu ? Vous avez quatre heures…
| 7 | Films des frères Cohen : The Big Lebowski |
Comme dans toute cérémonie ou spectacle, garder le meilleur pour la fin… À vrai dire, il faudrait rédiger « 7 raisons de considérer The Big Lebowski comme un sublime chef d’œuvre ». On n’a pas vérifié, mais existe-t-il un autre héros de film ayant inspiré un « art de vivre » jusqu’à en devenir religion ?
Oui, le Dudeism a ses adeptes, qui s’en remettent aux vertus de la coolitude en toutes circonstances : séances de bowling entre potes, glandage à la maison aux frais des services sociaux, saveurs d’un bon White Russian (vodka russe, kahlua – liqueur de café - plus un filet de lait bien frais) ; petites séances de fumette en sus, si affinités. Le Dude (insurpassable Jeff Bridges !) est son Messie, qui veut juste qu’on lui foute la paix, qui traverse le monde en tongues et bermuda, insensible aux convenances, et sans jamais savoir quel jour on est. Il est l’homme qui paye son pack de lait avec un chèque (en bois) de 75 cts, et écoute dans sa tire déglinguée de vieilles cassettes de Creedence.
À vrai dire le monde (pour pomper une réplique célèbre venue d’ailleurs) pourrait se diviser en 3 : ceux qui n’ont jamais vu The Big Lebowski. Ceux qui l’ont vu à la télé, version française, et du coup n’ont jamais pu capter en quoi ce film est un bonheur absolu. Car cette V.F. est probablement la plus consternante jamais produite. Le héros, The Dude (« Mec ») y devient « Le Duc », ce qui est juste idiot. Et les incompétents « en charge » sont parvenus à flinguer une des séances d’anthologie en détruisant la réplique hilarante et culte, répétée en boucle en mode hystérique : « You see what happens Larry, WHEN YOU FUCK A STRANGER IN THE ASS ? » en la traduisant par « Tromper une personne jusqu’au trognon ». Quand on sait que le mot « Fuck » apparait exactement 260 fois dans les dialogues, on mesure la débandade. La V.F. ne devrait se voir qu’ « ivre virgule ». Pour ne la savourer qu’au troisième degré uniquement.
Revenons à ce monde divisé en trois : il y a enfin ceux qui SAVENT. Qui parlent et commentent le monde tels Le Dude, vénèrent également son alter-ego, Walter Sobchak (immense, encore, ce John Goodman), aimable sociopathe obsessionnel vétéran du ‘Nam, seul catholique polonais s’évertuant à respecter Shabbat parce qu’il a jadis été marié à une israélite. Walter et le Dude, ainsi que leur pote ahuri Donny (impeccable Steve Buscemi) vont, sans comprendre ni comment ni pourquoi, se retrouver embringués dans une histoire sans queue ni tête, rançon d’un million de dollars qu’on leur confie, qu’ils vont perdre, vont galérer pour la récupérer, confrontés à deux factions rivales plus chtarbées l’une que l’autre.
Les cinéphiles repèreront qu’il s’agit l'air de rien d’une déconstruction déjantée du Grand Sommeil d’Howard Hawks, (The Big Sleep), transposée dans l’Amérique en crise des années 90. The Big Lebowski propose un sabotage en règle du Rêve Américain, vécu par trois déclassés au grand cœur, dont deux capables d’entrer en rage pour tout et son contraire. On tient LE prototype du cult movie, où s’enchaînent les scènes inoubliables, à chacun sa préférée. Il n’a pas trop marché à sa sortie, mais demeure peut-être un des rares qui sache faire rire « encore plus » chaque fois qu’on le revoit (je dois en être à la trentaine). Un des rares films sur lesquels on n’écrit pas un livre, mais DES livres, et pour lesquels on rivalise aussi de créativités graphiques. On peut s’offrir le gilet du Dude (je l’ai !), les lunettes de soleil de Sobchak, des mugs et tapis de souris aux couleurs DU tapis. Puisque là aussi il y a les autres, et ceux qui savent : ce tapis qui « harmonisait vraiment bien la pièce ». Pour ma part, je ne connais aucun anti-dépresseur aussi efficace que de s’avaler trois extraits à la suite sur le fuckin’ You Tube. Et suis convaincu qu’un homme qui aime The Big Lebowski ne saurait être vraiment mauvais.
| 8 | Films des frères Cohen : En Bonus |
Oui, il faut voir The Barber, (tel était son titre français, étrangement. Le titre original était "The man who was not there", « L’homme qui n’était pas là »). Film très noir, en noir et blanc, quasi mutique, traversé par quelques moments de grande cruauté morale.
Oui, on peut voir « A serious Man », même s’il est probablement le moins accessible au grand nombre, car le plus « juif » de tous, jouant avec les symboles religieux, la kabbale, les contes yiddish. Oui il faut voir O’Brother, évocation farfelue de l’Odyssée d’Homère, avec George Clooney et James Goodman en cyclope hystérique. Oui il faut voir Miller’s Crossing, film de gangsters au temps de la prohibition, et il faut voir True Grit, remake de « Cent Dollars pour un shérif », où Jeff Bridges enfile les bottes de John Wayne (à ce jour leur plus grand succès commercial). Il faut voir le très fantaisiste Arizona Junior, avec Nick Cage réjouissant dans un beau rôle de tocard. Une comédie mineure, mais qui donne à jubiler par moments.
En fait, il faut les voir tous, il y en a un peu plus d’une vingtaine, et dans tous il y a matière à savourer ce double regard, implacable et décalé, visant cette étrange nature humaine spécifique à la grande Amérique. Vivement le prochain ! On dit que ce sera Macbeth… Celui de Shakespeare ? Oui, oui ! Avec de nouveau Frances McDormand dans le rôle de la Lady... Et Denzel Washington… Et non, non, on parle bien de Macbeth et pas d'Othello.
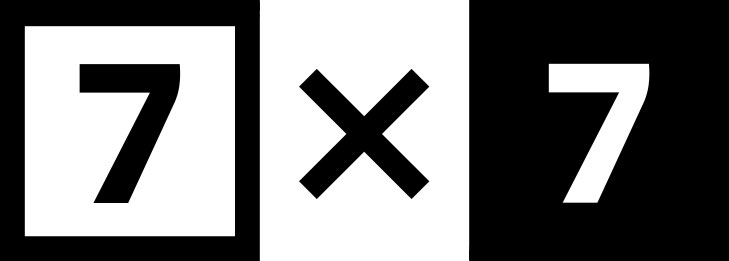
 Anticiper
Anticiper



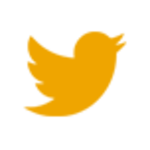









Commentaires